Deux chercheurs en sciences sociales démontrent le caractère arbitraire et injustifiable des rémunérations et avantages exorbitants dont se gavent les patrons multimillionnaires sur le dos des grandes entreprises cotées en Bourse. Deontofi.com revient sur leur article publié récemment par la revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale Ethique Publique, sous le titre « Les hauts revenus des chefs d’entreprises sont-ils justifiés » (1). Extraits commentés.

En examinant de nombreux travaux sur le lien éventuel entre les pactoles des dirigeants et leurs justifications les plus courantes (mérite, compétences rares, performances et motivation), deux chercheurs démontrent qu’aucun de ces arguments ne tient la route. (photo © GPouzin)
Depuis quelques années, les rémunérations et avantages extravagants dont se gavent les dirigeants de grandes entreprises cotées en Bourse nourrissent une vive polémique. Chacun sait que ces paquets de millions sont sans rapport avec l’échelle des revenus dans le reste de la société, et qu’ils appauvrissent les entreprises, au détriment de leurs salariés comme de leurs actionnaires. De leur côté, les lobbies patronaux et financiers défendent bec et ongle leur fromage, avec l’argument imparable de la liberté des affaires. De quel droit interdire, limiter ou entraver la rémunération que des entreprises décident de verser à leurs dirigeants avec l’aval de leurs actionnaires ?
En pratique, on sait qu’il s’agit davantage d’un abus de pouvoir rendu possible uniquement par la complicité d’administrateurs complaisants, plutôt que d’un choix volontaire des actionnaires d’appauvrir leur entreprise. L’approbation des résolutions en assemblée générale est une farce qui n’a guère plus de valeur démocratique qu’un plébiscite soviétique. Mais ce débat est surtout une diversion habile pour éviter soigneusement le fond du sujet : « Les hauts revenus des chefs d’entreprises sont-ils justifiés ».
David Robichaud et Patrick Turmel, respectivement professeurs agrégés de philosophie à l’Université d’Ottawa (Ontario) et à celle de Laval (Québec), répondent à cette question avec beaucoup de pertinence dans leur contribution au dernier numéro de la revue Ethique Publique, intitulé « Ethique et reconfigurations de l’économie de marché : nouvelles alternatives, nouveaux enjeux ». L’intégralité de leur texte est accessible directement ici.
Plutôt que de se laisser embarquer dans le faux débat sur la liberté d’entreprise, David Robichaud et Patrick Turmel ont choisi d’aborder la question des hauts revenus des dirigeants à la racine : leur justification. Cette justification par les lobbies patronaux et financiers fait bien sûr partie intégrante de leur arsenal de propagande. Mais, comme pour les plaidoiries des banquiers contre la taxation des transactions financières européenne, un examen détaillé des arguments justifiant les paquets de millions des dirigeants montre qu’ils ne tiennent pas la route.
Dans leur article, David Robichaud et Patrick Turmel constatent qu’on entend trois types de justification des pactoles exorbitants octroyés aux patrons de sociétés cotées. Premièrement, ils auraient du mérite : leur rémunération correspondrait à la juste rétribution de leurs efforts et de leur contribution exceptionnelle à la prospérité de leur entreprise, en gros. Deuxièmement, leur rémunération serait justifiée par leurs compétences si rares qu’elles les rendent quasi-irremplaçables, ou remplaçables seulement par des clones aussi chers. Troisièmement, vu la compétition entre multinationales occidentales pour attirer et retenir ces dirigeants irremplaçables, la surenchère serait un élément de motivation essentiel pour dynamiser leurs performances, et nécessaire pour ne pas perdre nos talents engloutis par une abominable fuite des cerveaux.
Or, après examen sérieux, David Robichaud et Patrick Turmel démontrent « qu’aucun de ces trois arguments ne permet de justifier les revenus actuels. Ils se butent à l’évaluation empirique, sont souvent indéterminés en ce qui a trait aux résultats qu’ils permettent de justifier ou sont moralement arbitraires ».
En préambule, les chercheurs rappellent que « l’écart entre ces hauts salariés et le travailleur moyen ne cesse de se creuser. Aux États-Unis, par exemple, le ratio entre le revenu des chefs d’entreprise et celui du travailleur « médian » est 14 fois plus important aujourd’hui qu’il ne l’était en 1965. Il est passé de 20 à 273 fois le salaire médian (Mishel, 2013) ».
Une dérive qui, selon eux, « s’explique peut-être aussi par une foi largement partagée dans la théorie du ruissellement économique, selon laquelle l’enrichissement de certains finit toujours par ruisseler dans l’échelle sociale, au bénéfice de la société tout entière. Si cette théorie économique ne tient pas la route – ni théoriquement ni empiriquement –, il n’en demeure pas moins qu’elle continue à influencer l’opinion publique (Robichaud et Turmel, 2012 : 76-79) ».
« Dans son ouvrage magistral, Le capital au xxie siècle, l’économiste Thomas Piketty suggère que cela s’explique en bonne partie par l’importante baisse du taux marginal supérieur de l’impôt sur le revenu depuis les années 1970 », ajoutent les auteurs, en notant plus loin que l’on sait, grâce à ses travaux « qu’aux États-Unis, les hauts dirigeants d’entreprise forment désormais 70 % du 0,1 % des personnes les plus riches (en matière de revenus) ».
Maigre mérite et maxi millions
« Les revenus du chef d’entreprise sont-ils le miroir de ses talents et de ses efforts ? Cette première version de la justification semble avoir un certain ascendant sur le public, qui se laisse ainsi parfois convaincre de la normalité, sinon de la moralité de ces hauts revenus », notent Robichaud et Turmel. Alors qu’en fait « cette première justification, selon laquelle le marché récompense ceux qui le méritent, au sens fort, c’est-à-dire ceux qui ont fait les efforts pour obtenir ces récompenses ou qui ont de plus grands talents (naturels ou acquis), ne résiste pas au problème de l’arbitraire moral. L’interdépendance sociale dans la création de la richesse, la chance et toute une série de déterminants, autres que le talent ou l’effort, expliquent bien davantage que le mérite individuel le succès (ou l’échec) socioéconomique ».
Bien sûr, « le mérite ou le talent individuel jouent un rôle dans la détermination du succès individuel », insistent les auteurs, mais il ne faut pas confondre mérite et compétences d’une part, et dissocier le mérite réellement personnel de son contexte social. « Déjà faut-il développer ces talents, expliquent les chercheurs. Or, leur développement sera plus ou moins efficace en fonction des occasions offertes à l’individu, occasions qui ne sont pas également partagées. » Ensuite, « Le contexte social et économique dans lequel se développent ces talents joue aussi un rôle important, rappellent David Robichaud et Patrick Turmel. Par exemple, un talent ne se traduit en gain économique que s’il y a une demande pour celui-ci », et de citer le cas de Bill Gates, fondateur de Microsoft, dont le talent informatique n’aurait pas eu la même valeur un siècle plus tôt, ni même aujourd’hui « maintenant que l’offre pour ce genre de talents s’est multipliée de façon phénoménale ».
A l’appui de cette démonstration relativisant le mérite individuel pour justifier les revenus exorbitants des dirigeants, les auteurs citent une très belle réflexion du milliardaire Warren Buffet, sur le rôle de son environnement et la chance d’avoir pu en profiter pour faire fortune : « Le système américain m’offre d’énormes récompenses pour ce que j’apporte à cette société, expliquait le sage d’Omaha. […] Je pense personnellement que la société est responsable d’un pourcentage très significatif de ce que j’ai gagné. Si vous m’envoyez au milieu du Bangladesh, du Pérou ou ailleurs, vous découvrirez ce que ce talent pourra produire dans un milieu moins propice. Je serai encore en train d’essayer de me sortir du pétrin trente ans plus tard. Je travaille dans un système de marché qui récompense très bien – de façon disproportionnée – ce que je sais faire (cité dans Lowe, 1997 : 73-74) ».
Le mérite individuel réel étant une notion relative et floue, il ne justifie pas les millions que s’octroient les dirigeants. A plus forte raison quand Warren Buffet explique lui-même que « la société est responsable d’un pourcentage très significatif » de ce qu’il a gagné, par rapport à son propre talent.
Des performances douteuses pas si irremplaçables
A défaut de pouvoir prouver que les rémunérations exorbitantes des dirigeants correspondraient à leur seul mérite individuel, ce dernier étant très discutable, la seconde justification de ces pactoles serait que « les compensations offertes aux dirigeants sont méritées si elles sont corrélées à sa performance économique – avérée ou ainsi justifiée par la performance économique des entreprises ou par la création de richesse rendue possible par leur président », expliquent ensuite les deux chercheurs.
Ils tentent de vérifier la solidité de cette thèse, présentée par Peter Dietsch, qui postule que « la rémunération sur le marché du travail suit les compétences acquises, et non les talents naturels », ce qui permettrait aux tenants de cette théorie de « défendre des inégalités salariales importantes en faisant appel à la remplaçabilité différentielle des individus » (2014 : 161-164) ». En gros, on pourrait justifier la rémunération d’un individu par « la difficulté de le remplacer ou la rareté des compétences qui sont les siennes – des compétences plus rares (et recherchées) étant associées à une rémunération plus substantielle ». Une approche frappée au coin bon sens, estiment David Robichaud et Patrick Turmel. Le problème n’est pas la méthode, mais sa perte de pertinence « surtout lorsque l’on s’approche des extrêmes en fonction de la facilité ou de la difficulté à remplacer quelqu’un ».

Éthique et reconfigurations de l’économie de marché : nouvelles alternatives, nouveaux enjeux. Un recueil d’articles académiques publié par la revue Éthique Publique, revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale sous la direction de la Chaire d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada), aux Éditions Nota bene, dans son n°2014-vol. 16, n°2.
Pour s’en convaincre, les chercheurs appliquent ce raisonnement aux pactoles des dirigeants. Selon cette méthode, « Si les compétences d’un individu permettent de maximiser les investissements des actionnaires d’une entreprise, il est légitime d’offrir une compensation qui convaincra cet individu de se mettre au service de celle-ci, et ce, peu importe son mérite eu égard à ces compétences », expliquent Robichaud et Turmel. Ils citent l’exemple de Jack Welch, ex-PDG vedette de General Electric, en rappelant que « La valeur de la société a augmenté de 4 000 % sous son règne, et lors de sa dernière négociation salariale, il a convaincu le conseil d’administration de lui verser une rémunération qui comprenait une indemnité de départ de 417 millions de dollars ». Si la corrélation entre rémunération et performance était toujours aussi claire, ils admettent que « Selon le modèle économique classique, basé sur l’idée de productivité marginale, une telle hausse des revenus est parfaitement justifiée si l’entreprise voit ses profits augmenter au moins à la hauteur de cette augmentation. Si l’on juge que ce dirigeant est le seul à pouvoir contribuer ainsi à la productivité de l’entreprise, il est alors considéré comme irremplaçable ».
Problème, cela ne marche pas à tous les coups. C’est même plutôt la tombola. A titre anecdotique, les chercheurs citent le cas d’un adjoint de Jack Welch, Gary Wendt. Cet As des performances avait gagné ses galons en tant que dirigeant de la division la plus rentable de GE, totalisant 40% des profits du groupe. Convaincu de sa capacité irremplaçable à créer de la valeur, la société Conseco.inc lui offrit un pont d’or de 245 millions de dollars pour le placer à sa tête, sans récolter le succès escompté. Jetant l’éponge avant d’avoir totalement essoré la boîte, Gary Wendt démissionna trois mois avant sa faillite.
Combien de boîtes en faillite après s’être payé un PDG de luxe ?
Leurs performances est donc un argument bidon pour justifier les pactoles des dirigeants, comme le confirme les travaux des chercheurs Lucian A. Bebchuk et Jesse M. Fried, qui « ont bien montré que la rémunération était davantage déterminée par le pouvoir et le rapport de force dont dispose un haut dirigeant et par la taille de l’entreprise qu’il dirige que par sa performance. Dans les années 1990, décennie d’explosion de leurs rémunérations, « les gestionnaires ont fait jouer leur influence pour obtenir des compensations plus importantes en privilégiant des arrangements salariaux fortement indépendants de la performance. […] La rémunération des dirigeants est beaucoup moins liée à la performance qu’on ne le croit généralement » (Bebchuk et Fried, 2006 : 6.).
En s’appuyant sur une autre étude, les auteurs observent même que « les procédures visant à déterminer la rémunération à octroyer à un chef d’entreprise sont de plus en plus indépendantes de sa performance. Certains vont même jusqu’à mettre en question tout lien entre la performance de ce dernier et celle de l’entreprise (Khurana, 2002 : 23) ».
L’évolution inverse entre les rémunérations et les performances a même été quantifiée : « Dans les années 1990, malgré une augmentation importante des compensations offertes aux dirigeants et une explosion de leurs revenus, les deux tiers des fusions ont été des mauvaises décisions de la part des chefs d’entreprise, 80 % des nouveaux produits n’ont pas survécu à leurs douze premiers mois sur le marché et les marges de profit des entreprises n’ont pas augmenté ».
Pire. C’est un cauchemar de déontologie financière : « Une étude menée sur vingt ans et portant sur les 25 chefs d’entreprise les mieux rémunérés aux États-Unis pour chacune de ces années nous apprend que près de 40 % d’entre eux ont vu leur entreprise fermer ses portes ou être renflouée par des fonds publics pour éviter la faillite (22 %), ont été congédiés (8 %) ou étaient à la tête d’entreprises qui ont été accusées de fraude et qui ont dû payer des sommes importantes en amendes ou en règlements de toutes sortes (8 %) (Institute for Policy Studies, 2013) ».
Plutôt que d’évoquer une prétendue rémunération à la performance des dirigeants, les auteurs estiment avoir affaire à un « fétichisme de la compétence » : « où l’on justifie la compensation de compétences pour elles-mêmes, et non pour ce qu’elles permettent d’espérer au chapitre des gains pour l’entreprise ». Nos chercheurs vont jusqu’à envisager qu’un tel fétichisme puisse se justifier par « la nécessité d’envoyer un signal au marché. On peut en effet imaginer qu’il est bon pour l’image de marque d’une entreprise que son président soit mieux payé que celui des compétiteurs. Pensons à ce sujet aux classements annuels des magazines d’affaires. On n’y présente jamais le palmarès des meilleurs dirigeants, toujours celui des mieux rémunérés. Il fait peu de doute que cela a une influence sur la perception que le public – et donc les actionnaires potentiels – a de l’entreprise. Celle-ci fait ainsi savoir au public qu’elle profite d’un président irremplaçable ».
Le problème est que dans une telle logique, « chaque entreprise se voit forcée d’offrir des compensations toujours plus importantes, non pas pour améliorer son sort sur le marché, mais simplement pour demeurer dans la course », ce qui relève d’une sorte de suicide collectif puisque cette surenchère « produit, du point de vue global, de véritables pertes nettes, et contribue de manière importante à la spirale actuelle des inégalités ».

Les rémunérations des dirigeants n’ont aucun lien avec une justification prouvable (performances, etc.). Elles sont fixées à des niveaux arbitraires reflétant la capacité de leurs bénéficiaires à décider eux-mêmes du montant octroyé par leur entreprise. (photo © GPouzin)
Laissez tomber cette absurde justification des rémunérations par la performance. Par quel bout qu’on la prenne, cette explication invérifiable dans les faits ne tient même pas la route en théorie.
Alors resterait l’argument de la motivation, troisième justification communément observée pour tenter de légitimer les rémunérations abusives. « Une variante de l’argument en faveur de salaires élevés fondé sur la motivation connaît aussi beaucoup de succès dans le milieu des affaires depuis les années 1990, notent David Robichaud et Patrick Turmel. Cet argument, mis en avant par des économistes pour inciter les actionnaires à ne pas lésiner sur l’octroi de compensations généreuses aux hauts dirigeants, semble intuitivement correct : plus ses dirigeants sont motivés à améliorer leur performance par des incitatifs pécuniaires, plus l’entreprise et ses actionnaires en profiteront ».
Motivation décroissante et incitations à double tranchant
Certes, mais il y a un hic ! « Le problème avec cet argument est qu’il présume que l’augmentation des salaires entraîne de façon continue une augmentation de la motivation, qui entraîne à son tour une augmentation de la performance », décrivent les auteurs. Or, chacun sait que « La motivation que produisent les premiers 100 000 $ offerts à un dirigeant est sans doute beaucoup plus grande que les 100 000 $ qui viennent s’ajouter à un salaire de plusieurs millions ». Une étude de Bebchuk et Fried de 2006 a même démontré que durant les années 1990 « les entreprises auraient pu produire les mêmes incitatifs de performance à de bien moindres coûts ou auraient pu utiliser les sommes versées pour produire des incitatifs de performance beaucoup plus efficaces ».
Après avoir tenté en vain de vérifier les corrélations entre rémunération et performance ou motivation, David Robichaud et Patrick Turmel reviennent au constat, prouvé par de nombreux travaux, que « la satisfaction individuelle n’est pas déterminée par la fortune absolue dont dispose un individu, mais plutôt par sa position relative par rapport à la fortune des individus composant son ensemble comparatif (Frank, 1999 et 2007) ». Du coup, ce n’est pas un hasard si « la justification des revenus des chefs d’entreprise fait généralement référence aux revenus offerts aux dirigeants d’entreprises comparables dans le même secteur ». Parce qu’ils se valent bien, en quelque sorte.
Si la surenchère de salaires des dirigeants n’a aucune autre justification rationnelle que le pouvoir qu’ils ont sur la fixation de leur propre rémunération, on ne peut pas exclure, en revanche, « que les incitatifs financiers augmentent la motivation extrinsèque des dirigeants, mais que cette motivation ait des effets pervers sur leur performance, expliquent les chercheurs. Elle peut soit miner la motivation intrinsèque, associée à la créativité et à la résolution de problèmes complexes (Amabile, 1996), soit faire augmenter la pression sur les dirigeants, ce qui peut avoir pour conséquence de nuire à leur performance ».
Ce n’est pas de l’ironie gratuite, car une autre étude démontre la façon dont les incitations financières peuvent améliorer ou détériorer les performances des individus selon les circonstances.
David Robichaud et Patrick Turmel citent ces travaux de Daniel Pink prouvant que : « les incitatifs pécuniaires ont une influence significative sur la réalisation de tâches simples et machinales (tâches arithmétiques), mais ils nuisent souvent à la réalisation de tâches impliquant la créativité et la résolution de problèmes (tâches heuristiques). Augmenter les bénéfices offerts à des individus – notamment sous la forme de prime – pour réaliser de telles tâches plus complexes réduit souvent leur performance par rapport à d’autres individus n’ayant pas reçu d’incitatifs pécuniaires. Cela semble laisser croire que ces incitatifs augmentent la motivation extrinsèque, mais que cela peut avoir plusieurs effets pervers qui sont ici pertinents. Pink en mentionne sept (2009 : 57).
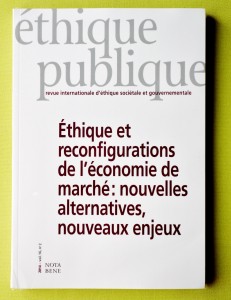
Éthique et reconfigurations de l’économie de marché : nouvelles alternatives, nouveaux enjeux. Un recueil d’articles académiques publié par la revue Éthique Publique, revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale sous la direction de la Chaire d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada), aux Éditions Nota bene, dans son n°2014-vol. 16, n°2.
Les incitatifs pécuniaires peuvent :
- réduire la motivation intrinsèque ;
2. diminuer la performance ;
3. nuire à la créativité ;
4. miner les bons comportements ;
5. encourager la triche, les raccourcis et les comportements non éthiques ;
6. créer des dépendances ;
7. promouvoir la pensée à court terme. »
En conclusion, David Robichaud et Patrick Turmel confirment que « les compensations, au-delà d’un certain seuil, cessent d’apporter un quelconque bénéfice aux actionnaires. Ensuite, du point de vue de l’éthique, les sommes offertes aux hauts dirigeants qui ne se traduisent pas par une performance supérieure de l’entreprise sont des sommes perdues par les actionnaires. Or, comme ces actionnaires n’ont que très peu de pouvoir dans les prises de décision entourant la rémunération des dirigeants, cela s’avère être un problème d’éthique des affaires ».
En clair : les rémunérations abusives créant un préjudice collectif à la société qui n’a pas les barrières immunitaires suffisantes pour s’en défendre, l’Etat est légitime à encadrer cette dérive portant atteinte à l’intérêt général, notamment par sa politique fiscale, rappellent les auteurs en citant Piketty : « quand on taxe une tranche de revenus ou de successions à un taux de l’ordre de 70 %-80 %, il est bien évident que l’objectif principal n’est pas de lever des recettes fiscales (et de fait ces tranches n’en rapporteront jamais beaucoup). Il s’agit in fine de mettre fin à ce type de revenus ou de patrimoines, jugés socialement excessifs et économiquement stériles par le législateur, ou tout du moins de rendre extrêmement coûteux leur maintien à ce niveau et de décourager très fortement leur perpétuation (2013 : 815-816) ».
Et pour ceux qui douteraient encore de cette nécessité, « le fait que la société dans son ensemble est responsable de la plus grande part de la richesse produite justifie qu’elle ait son mot à dire sur la distribution de celle-ci », rappellent enfin David Robichaud et Patrick Turmel.
(1) Retrouvez ici « Les hauts revenus des chefs d’entreprises sont-ils justifiés » dans son texte intégral avec la bibliographie des études citées par ses auteurs, David Robichaud et Patrick Turmel.
Ce texte a été publié par la revue Éthique Publique, revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale sous la direction de la Chaire d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada), aux Éditions Nota bene, dans son n°2014-vol. 16, n°2 : Éthique et reconfigurations de l’économie de marché : nouvelles alternatives, nouveaux enjeux.
